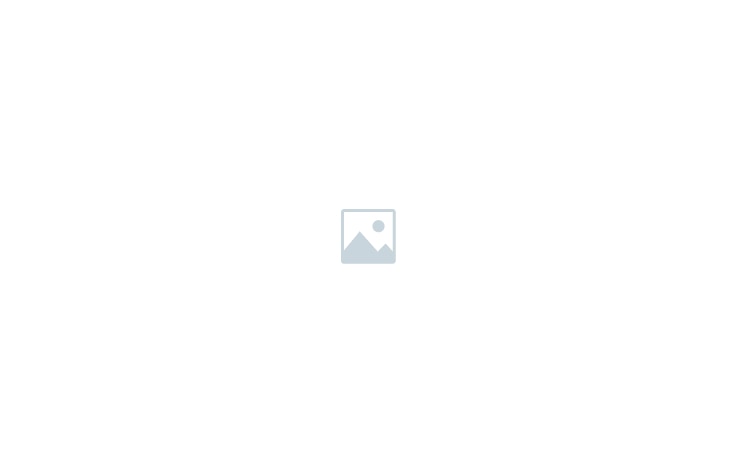Le Canada dans lequel je vis aujourd’hui est très différent de celui dans lequel je suis arrivée il y a près de 60 ans.
À l’époque, le Canada venait tout juste de nommer la première femme à un poste de ministre fédéral, Ellen Fairclough. L’élection de la première députée noire, Rosemary Brown, à une assemblée législative provinciale ne viendra qu’en 1972, ici, en Colombie-Britannique. L’adoption d’une protection constitutionnelle pour l’égalité entre les genres ne se fera que 10 ans plus tard.
Le Canada a parcouru un long chemin depuis et il est maintenant considéré comme un chef de file sur la scène internationale.
Nous n’avons pourtant toujours pas atteint une véritable égalité et je la désire impatiemment, au Canada comme ailleurs. Le moment est venu pour que nous la voulions tous.

PLUS DE CANADA
Il y a quelques semaines, aux côtés d’une centaine de personnes, j’ai participé à un événement de Carrefour International. C’est une organisation que je soutiens depuis longtemps et qui contribue à faire progresser les droits des femmes et des enfants dans certains des pays les plus pauvres du monde. Je suis d’autant plus heureuse de la présence de Lawrence Hill à cette soirée, un écrivain et un défenseur des droits des femmes, car nous avons aussi besoin d’hommes de bien pour remporter cette bataille.
Les événements comme celui-ci sont inspirants puisqu’ils reconnaissent le travail de terrain des volontaires canadiens. Pas toujours glamour, leur travail est essentiel à la réussite scolaire de jeunes filles, au soutien de femmes qui fuient la violence et la pauvreté, et à l’analyse des lois qui devraient faire avancer l’égalité des genres.
Toutefois, c’est avec des sentiments partagés que j’ai entendu l’horrible réalité vécue par beaucoup trop de femmes et de filles en Afrique subsaharienne : des histoires de violences inimaginables, d’inégalités structurelles, et de pauvreté apparemment inéluctable qui alimentent les migrations forcées.
Pourquoi le monde n’en fait-il pas plus pour ces filles et ces femmes? Pourquoi le Canada n’en fait-il pas plus? Pourquoi ne parlons-nous pas au moins de cette crise humanitaire?
Une longue campagne électorale vient tout juste de se terminer et les seules discussions notables sur le rôle du Canada à l’international que j’ai entendu proposaient de réduire notre rôle dans l’accueil des réfugiés et des immigrants et de diminuer de 25 % les fonds publics destinés à l’aide au développement.

NOUS POUVONS ET NOUS DEVONS FAIRE MIEUX
La réponse à ces questions réside peut-être dans un récent changement d’attitudes et de rhétorique envers les femmes, qui avant étaient celles de groupes marginaux, mais qui semblent devenir celles du prétendu courant dominant.
Si la marche vers l’égalité était autrefois constante, bien que trop lente à mon goût, j’ai bien peur qu’aujourd’hui nous ne perdions du terrain de ce côté.
À cet égard, nous sommes sans l’ombre d’un doute vulnérables aux tendances mondiales, dont la plus grossière est le président des États-Unis. L’intimidation qu’il fait subir à ses opposantes, ses blagues sur le harcèlement sexuel, ses attaques politiques envers les droits des femmes, particulièrement les plus impuissantes de la planète, servent d’excuses et d’encouragements aux hommes, surtout ceux qui occupent des postes de pouvoir, afin d’ignorer ou, pire encore, de punir les femmes.
Je crois comme plusieurs que le comportement du président n’est pas seulement un problème, mais aussi un symptôme. Les révélations du mouvement #MeToo ont dévoilé la violence systémique subie par les femmes et les filles victimes d’hommes puissants.
Beaucoup trop de femmes se font violemment ridiculiser en ligne au Canada. Le féminicide et son manque de visibilité comme crise de santé publique sont troublants. Comme l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées l’a révélé, les femmes autochtones demeurent particulièrement vulnérables.
le sexisme est toujours la
Même les femmes qui jouent des rôles de premier plan dans les milieux universitaires et professionnels font face à un plafond de verre, que ce soit dans les conseils d’administration ou dans l’arène politique.
Sur la scène internationale, même les femmes qui reçoivent le prix Nobel ne sont pas à l’abri de la marginalisation. Esther Duflo, une économiste franco-américaine qui fait un travail révolutionnaire dans le domaine de la réduction de la pauvreté, a reçu un prix Nobel conjointement avec les professeurs Abhijit Banerjee, son mari indo-américain, et Michael Kremer. Et pourtant, le soi-disant plus important journal d’actualité économique de l’Inde ne fait référence à Mme Duflo que comme la « femme » de M. Banerjee.
Tout ceci me laisse profondément inquiète pour le futur des jeunes filles. J’espère qu’elles verront en Rosemary Brown et Esther Duflo une source d’inspiration. D’ailleurs, elles nous regardent aussi pour avoir une vraie discussion et elles veulent que nous nous joignions à elles afin d’agir.
Nous ne pouvons pas les laisser tomber. Il n’y a pas de temps à perdre.
Je pense aussi aux jeunes femmes qui luttent déjà pour faire changer les choses : je pense à Greta Thunberg et à la justice climatique, à Autumn Peltier et à la protection de l’eau, et à Rebeca Gyumi et à l’abolition du mariage des enfants.
Et je continue de me battre aussi. Joignez-vous à nous.